Patrimoine : Connaissez-vous l’histoire architecturale de notre Mairie ?
Focus
Mise à jour le 16/04/2025

L'incendie qui a touché le beffroi et une partie de la toiture de la mairie en janvier dernier nous a fait prendre conscience de l'importance et de la fragilité de ce patrimoine commun. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire de ce bâtiment ?
En 1860, les limites de Paris sont étendues jusqu’à
l’enceinte de Thiers, édifiée en 1844 : les communes limitrophes situées
dans cette enceinte sont annexées. La ville est alors partagée en 20
arrondissements et le 12e compte quatre quartiers : les « Quinze
Vingt », « Bel Air », « Picpus » et «
Bercy ». C’est dans le bâtiment de la Mairie de l’ancien village de
Bercy, sur la place Lachambeaudie (ex-place de la Nativité), que la Mairie du
12e est d’abord installée. Pour tous les nouveaux arrondissements nés de
l’annexion, dès 1865, le préfet de la Seine, le baron Haussmann, organise la
construction de nouvelles Mairies. Celle du 12e arrondissement est confiée à
l’architecte Antoine-Julien Hénard (1812-1887) et un emplacement plus central
est choisi, le long du chemin de fer de la Bastille inauguré en 1859. Son
chantier ne sera amorcé qu’à la suite de l’incendie qui détruisit la première
Mairie, lors de la Commune de Paris de 1871. A la suite de la Commune,
l’administration républicaine demande à l’architecte de réviser les plans afin
de donner au bâtiment une allure plus sobre et des aménagements intérieurs plus
fonctionnels, consacrés à l’accueil des différents services. Le bâtiment que
nous connaissons aujourd’hui est ainsi construit entre 1874 et 1877.
Hénard s’inspire des styles Renaissance, Louis XIII, Louis
XIV et agrémente l’édifice de colonnes, de bossages, de lucarnes et d’un
campanile. Ce beffroi octogonal très ouvragé, haut de 36 mètres et
comportant deux étages, domine l’édifice. Le plan d’époque ci-contre offre à
notre appréciation l’ensemble de ses détails architecturaux, qui en font toute
l’élégance. La charpente entière est supportée par deux poutres armées en fer,
parallèles aux murs de la façade, et reposant sur les deux murs latéraux du
pavillon d’entrée. Quant aux combles, établis sous la forme de combles à la
Mansart, ils sont couverts en zinc sur les deux pans les plus élevés
(terrassons) et en ardoise sur les deux pans presque verticaux (brisis). Ce
choix de l’architecte, particulièrement courant, assure l’étanchéité de la
toiture.
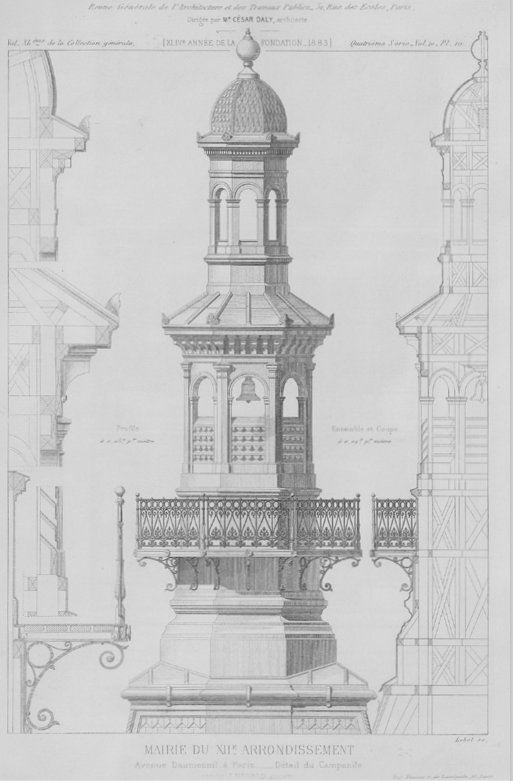
Source : Revue Générale de l’Architecture et des Travaux Publics (4e Série. - 10e VOL. pl.10 - 1883)
Crédit photo :
Revue Générale de l’Architecture et des Travaux Publics (4e Série. - 10e VOL. pl.10 - 1883)
